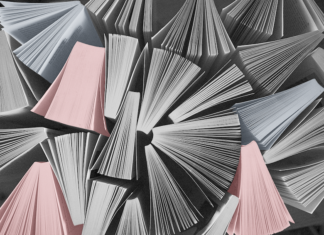Agnès P. est une ancienne infirmière au travail. Victime de burn-out, elle retourne dans les locaux de son ancien employeur pour sensibiliser chacun à ce mal, sournois. Un récit touchant qui livre la bataille qu’elle pensait mener contre le corps médical, avant d’accepter sa propre souffrance.
Le kintsugi est l’art japonais qui consiste à réparer des céramiques avec des jointures en or. Réparer et embellir, donc. C’est ce à quoi pense Agnès P., infirmière en santé en travail de 62 ans quand elle évoque son burn-out. « Je n’ai pas fait ce burn-out pour rien, mais c’est un sujet grave, qui, lui, ne doit pas être embelli », affirme-t-elle. Mais il est pour elle une expérience à partager pour sensibiliser les travailleurs à cette souffrance. Une sorte de mal pour un bien, comme le kintsugi. En effet, Agnès intervient dans une grande entreprise, la dernière où elle travaillait, pour partager son vécu : « Je retourne témoigner dans l’entreprise où je suis tombée. »
Ce qu’il s’est passé ? Un mal insidieux qui l’a rongée petit à petit, comme provoquent souvent les épuisements professionnels. Et Agnès ne s’était rendu compte de rien.
L’infirmière, celle qui doit aider les autres
Agnès a débuté sa carrière en tant qu’infirmière dans le milieu hospitalier, avant d’exercer en libéral et de faire quelques remplacements. C’est lors d’une mission qu’elle découvre le métier d’infirmière en santé au travail. Elle officie pendant cinq ans dans une entreprise de la grande distribution avant de rejoindre une association qui place des assistances sociales et des infirmières dans les entreprises. C’est ainsi qu’Agnès rejoint sa dernière mission en 2012. Elle en profite pour s’inscrire en licence de santé au travail en faisant valoir une validation des acquis de l’expérience (VAE). Un challenge passionnant mais chronophage.
Les choses se compliquent lorsqu’en 2017, le médecin du travail, rattaché à l’entreprise où elle est affectée, part. « Je perds alors un cadre de travail, les contours de mon poste deviennent beaucoup plus flous, se souvient l’infirmière qui devient alors sur-sollicitée. Le matin, j’arrivais très tôt, le soir je partais très tard. Et c’est comme ça que le mal s’est installé. Pourtant, j’avais des signaux d’alertes : des migraines, des entorses, des caries, etc. Mais je les ignorais, je me disais qu’ils finiraient bien par passer. » Pour elle, une infirmière est celle qui doit toujours aller bien, celle qui s’occupe des autres avant tout : « Je n’avais pas un sentiment de toute puissance, mais d’indispensabilité. Mon cerveau s’est divisé en deux, entre l’expertise de l’infirmière qui s’inquiétait pour elle-même et la salariée endurante, qui veut bien faire quoi qu’il arrive. » Sauf qu’un matin, lors d’une réunion entre confrères à l’association qui l’emploie, Agnès n’y arrive plus : « Je me suis dit que je ne pouvais y retourner, que c’était trop loin. Alors que j’y rendais tous les jours, facilement, depuis des années ! »
20 heures de sommeil par jour
Agnès consulte alors son médecin traitant. Par chance, en quelque sorte, il est absent. C’est une remplaçante qui reçoit l’infirmière, une remplaçante qui ne la connait pas et observe ses maux avec beaucoup de recul. Agnès pensait demander deux-trois jours de repos. Le médecin l’arrête quinze jours. Et renouvelle, après chaque période, l’arrêt. S’en suit alors une longue marche de négociation entre Agnès, qui refuse d’être malade, et les professionnels de santé qui l’exhortent à lever le pied : « C’était difficile pour moi d’aller chez le médecin car j’avais un sentiment de culpabilité. Le médecin m’arrêtait, mais il fallait que je trouve un subterfuge pour accepter moi-même d’être arrêtée. »
Lorsqu’elle est arrêtée pour un mois d’emblée, elle relâche tout. « Je me suis mise à dormir 20 heures par jour, j’étais au bout de mon corps », admet-elle. Commence aussi un vrai travail sur elle-même, auprès de psychologues et d’associations comme Souffrance et travail. « Je devais apprendre à me dire que ce n’était pas de ma faute ce qu’il se passait », partage-t-elle. Agnès ne travaille plus durant deux ans, de janvier 2020 à septembre 2022, pour finalement être licenciée pour inaptitude. Là encore, c’est une nouvelle épreuve pour l’infirmière : « C’était très dur à entendre. Il a fallu que je travaille avec mon psychologue sur ces deux mots, ‘licenciée’ et ‘inapte’. »
La méconnaissance du burn-out
A plus de 60 ans, Agnès ne tient pas à finir sa vie professionnelle comme ça. Elle a gardé de bons contacts avec sa dernière entreprise et elle finit par se confier sur les raisons de son absence à la responsable des ressources humaines. Celle-ci lui propose de venir témoigner. Lors d’une journée en janvier, Agnès revient alors dans les locaux et décrit ce qu’elle a vécu auprès de trois assemblées de collaborateurs. « Dans le deuxième groupe, je me suis rendu compte que personne n’avait attrapé son téléphone durant tout le temps où j’ai parlé. Dans le troisième, j’ai vu une collaboratrice pleurer. Je me suis alors souvenue que son mari avait fait un burn-out. Elle est venue me voir, ensuite, pour se confier : ‘je n’avais pas conscience de ce que la personne en burn-out pouvait vivre’… »
L’infirmière apprécie que ses mots aient été parlants et que, surtout, ils contribuent à faire la lumière sur le burn-out, encore trop méconnu. « Souvent on pense que le burn-out ne touche que les personnes fragiles, c’est faux ! Tout le monde est concerné, car plus on tire sur la corde, plus elle se casse et plus on tombe loin. » Aujourd’hui, Agnès espère poursuivre son travail de sensibilisation en témoignant dans d’autres entreprises. Pour qu’elle n’ait pas fait son burn-out « pour rien ».
Pour ne rater aucune actualité en matière de qualité de vie au travail, inscrivez-vous à la newsletter de My Happy Job, parcourez nos hors-séries thématiques et découvrez notre annuaire du bien-être au travail.
A lire aussi :
– Si, si…il y un « après » burn-out !
– 5 chose à savoir sur le déni de burn-out